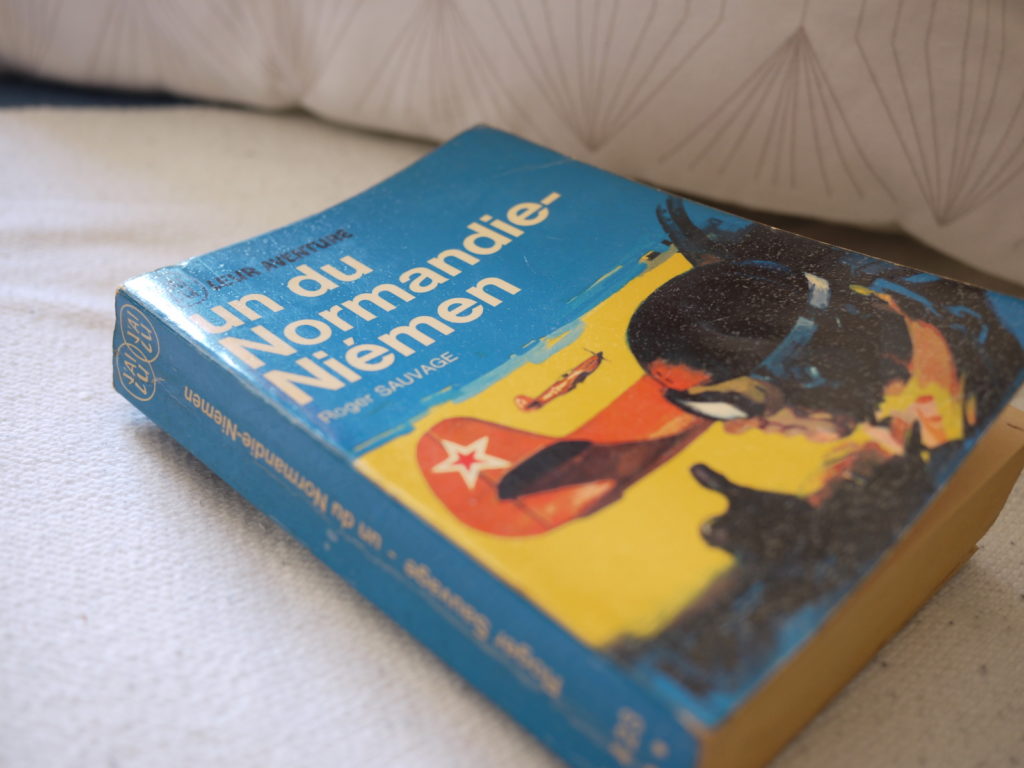La table du salon était impeccablement propre. Pas une poussière ne venait perturber le lustre du bois verni. C’était un beau plateau en bois brun chatoyant . Du merisier, probablement. Classique. Le large plateau était encadré de 6 chaises du même acabit, à l’assise tendue d’un genre de velours cramoisi un peu défraîchi mais là aussi, soigneusement entretenu. Le plateau était un peu encombré de tout un tas d’empilement. Une petite boîte en carton, genre boîte à chaussure d’enfants, contenait une profusion de médicaments et de matériel médical. Un lecteur de glycémie, plusieurs seringues d’injection. À côté, des papiers imprimés, soigneusement triés, portaient la marque de pliure indiquant qu’ils était arrivés par la poste. D’un coup d’œil, on pouvait lire des trajets de train, une correspondance, un plan, une réservation dans une auberge. Les éléments importants étaient surlignés. Un numéro de téléphone était écris en gros en tête de page, au stylo noir. Un cahier d’écolier, lui aussi soigneusement aligné, avec un stylo Bic transparent, complétait l’alignement qui se terminait par une orchidée violette magnifique. Au centre enfin, une bonbonnière trônait.
Derrière les sièges, imposant, régnait un buffet vaisselier du même bois. Massif, les coins arrondis et les corniches un peu moulurées, il écrasait de son poids toute la pièce. Impeccablement vernis, soigneusement épousseté ses étagères du haut n’étaient pas garnies de vaisselles mais d’une collection de figurines en porcelaine. On pouvait distinguer des santons, et des représentations de divers personnages ruraux, de la lingère au berger. À côté du buffet, une porte vitrée donnait sur un couloir d’où s’échappaient deux voix féminines.
– Et alors il y avait ce mot ci, dans le courrier, bien plié. Regardez Mme Pernin. C’est l’écriture de la petite Inès, n’est ce pas une jolie écriture ?
On distinguait nettement la voix un peu perchée de Jeanne.
– Il y avait les billets, avec. C’est si gentil. Oh, je le savais, Emilie m’avait déjà tout dit. C’est une auberge, à quelques kilomètres seulement de la maison.
– Mais pourquoi avoir refusé d’aller dans la maison ? Vous m’aviez pourtant dit que c’était grand, et qu’ils vous avaient promis une chambre seulement pour vous.
– Jamais je n’aurai voulu. Vous savez je n’ai pas quitté cette maison depuis des années, des décènies mêmes. Non, je n’allais pas me retrouver tout le temps avec eux. J’ai mes habitudes, et je dors peu, je n’ai pas leur rythme, je le vois bien quand ils viennent ici quelques jours ce n’est pas vivable pour moi. Je lui avais dit…
– et c’est pour ça qu’elle a cherché cet hôtel ? Vraiment Jeanne, votre petite fille est une crème.
– une auberge. C’est une auberge. Surement que c’est plus familial qu’un hôtel et avec moins de manière, en tout cas j’espère. Et ils viendront me chercher le matin, un jour sur deux à peu près, et comme ça je suis avec eux et Inès, mais pas tout le temps, c’est bien ainsi. Je ne dérange pas, et je reste tranquille. Voyez, le prospectus ? Il y a même un étang à coté.
On entendait quelques papiers changer de main.
– Quand même à votre âge, quelle aventure ! Mais rassurez vous, Jeanne, pour le jardin, c’est parfait, je m’occupe de tout. Il sera impeccable à votre retour, j’ai promis.
– Oh ce n’est pas si grave, je vous épuisez pas à la tâche, vous avez déjà votre ouvrage, repris la voix de Jeanne. Pensez juste à ramasser les tomates mures, et donnez les à monsieur le curé, il saura bien les distribuer. Je vous ai montré où étaient les boites ?
– Déjà avant-hier, Jeanne, déjà avant-hier. Je sais tout, partez tranquille ! En plus, on a tout le temps d’en reparler, c’est dans plus de 10 jours le grand départ !