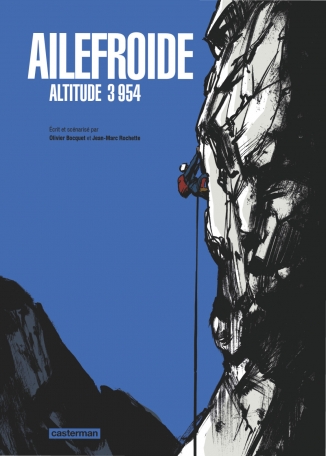– Oh, non, je n’ose pas te le dire, j’ai trop honte, ça me gène…
– Mais si, mais si, voyons, tu m’en as trop dit désormais je veux savoir !
J’ai fait 2 tentatives pour rentrer chez mon employeur actuel. J’ai été recalé une première fois, il y a plus de 10 ans déjà, par une directrice marketing. Je sais cependant que j’étais en finale. La seconde tentative, deux ans plus tard, fut la bonne, auprès d’un autre manager. Elle, je l’ai depuis croisée de nombreuses fois dans les couloirs, sans jamais oser, stupidement, l’aborder et reparler de notre entretien. Je savais exactement pourquoi : la première fois, sûr de moi à la limite de l’arrogance, j’avais osé quelques questions qui, à l’aune de la mentalité de l’entreprise que je connais si bien maintenant, ne pouvaient pas correspondre. 2 ans après, et une déception professionnelle dans les pattes, j’avais muri, j’étais préparé, structuré, j’avais plus envie que jamais de rejoindre cet industriel français, j’étais plus humble. De fait, plus en cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
J’ai été reçu. 2 ans après je devenais manager en prenant la place de ma chef. Encore 5 ans, aujourd’hui donc, et je franchis un échelon de plus en prenant, encore, la place de mon chef.
C’est à un pot de départ en lien avec cette évolution, que nous nous sommes croisés de nouveau. J’avais muri, encore. J’avais besoin de savoir. Et c’est elle qui est venue me voir, pour me féliciter d’une intervention de ma part à laquelle elle avait assisté, qu’elle avait trouvée très bonne. J’étais flatté. Et j’avais besoin de savoir.
– Je voulais te demander… te souviens-tu que…
– Oui, oui, Baptiste, je sais que je t’ai eu en entretien, ça ne s’est pas fait, l’histoire montre que j’ai peut-être eu un peu tort
– Justement… on pourrait en reparler ? Je voudrais savoir un truc…
– Oh non, je sais ce que tu vas dire, j’ai trop honte, ça me gêne…
Alors on a repris un verre, et elle m’a expliqué. Elle avait le souvenir de l’ambition d’un jeune homme de 29 ans, oui, d’une aisance avec la langue, d’une appétence technique poussée, trop peut être pour ce qu’elle cherchait, ce qui l’a mené à préférer un autre que moi. D’arrogance ? Non.
J’étais bouche bée.
– Mais alors… honte de quoi ?
– Vraiment, tu me pardonneras, mais je suis sortie de cet entretien très déstabilisée, avec une grosse remise en question, car j’ai réalisé que je t’avais peut être poussé dans des retranchements où tu ne voulais pas aller, où je n’aurai pas du t’emmener, et c’était inapproprié.
– Je ne comprends pas… Dis-moi…
– Voila, moi, j’embauche des compétences mais aussi, tu connais le groupe, une personne. J’ai besoin de connaitre cette personne. Je t’ai demandé donc qui tu étais, si tu avais des enfants, si tu en voulais. Tu m’as balancé d’un bloc que tu étais marié à un homme et que la question d’enfants ne se posait pas pour toi. J’ai réalisé que je t’avais forcé à te dévoiler, que ça n’était pas correct, que j’étais allé dans ton intimité, je m’en suis beaucoup voulue. Je n’ai jamais osé venir te voir depuis lors.
Je suis resté ébahis. 2 ans après, dès l’entretien avec celui qui allait m’embaucher, je m’assurais de lancer l’info de mon homosexualité, comme ça, mine de rien. Pas question d’être dans le placard, pas question d’être dans une équipe où ça poserait problème. Ca n’en a posé aucun. Ma visibilité, je le sais, a aidé quelques collaborateurs à sortir du placard.
Restait, en rentrant de cette soirée, sur le vélo, cette réflexion très nette que l’homosexualité ne sera plus un problème, le jour où une personne, dont l’ouverture d’esprit ne fait aucun doute, ne se sentira pas coupable d’avoir posé une question anodine et humaine à un inconnu, simplement parce que cet inconnu y aura répondu par un simple “je suis marié à un homme et ne compte pas avoir d’enfants”.
Alors moi, je continuerai d’être visible, sans tambours ni trompette, je continuerai de dire que le dernier weekend de juin c’est la gay pride, je continuerai de raconter mes soirées avec les copains dans les bars du marais, je continuerai de comparer en riant “mon” drag race à “leur” ligue 1.
C’est ma pierre à l’édifice.